 ➽ Découvrez le fascinant projet Prehistory Travel ainsi que ses coulisses à travers les yeux de ses fondatrices Alexia et Mathilde. C’est parti ! ✅*
➽ Découvrez le fascinant projet Prehistory Travel ainsi que ses coulisses à travers les yeux de ses fondatrices Alexia et Mathilde. C’est parti ! ✅*
Vidéo
Version « Rafale » :
Version intégrale :
https://www.youtube.com/watch?v=0c5Juw4wsy4
Podcast
Version « Rafale » :
Version intégrale :
Retranscription de l’interview
Mister Fanjo : Bonjour à tous, bienvenue dans l’émission Interview Rafale. Le concept est simple : retrouvez dans chaque épisode les pépites d’une interview avec un ou plusieurs invités qui se sont prêtés à une série de questions rafales. Découvrez leurs projets, leurs habitudes quotidiennes, leurs recommandations en termes de séries, musiques ou chaînes YouTube, et plus généralement, leurs conseils basés sur leurs propres expériences personnelles. Aujourd’hui, nous accueillons Alexia et Mathilde qui vont nous parler de leur fascinant projet Prehistory Travel. Sans plus tarder, découvrons les meilleurs extraits de leur interview. C’est parti !
Présentation de Mathilde et Alexia
Mister Fanjo : Avant de rentrer dans les détails de votre parcours et projet, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ainsi que votre projet ?
Mathilde : Je m’appelle Mathilde et je suis la cofondatrice de Prehistory Travel avec Alexia. Initialement, je ne viens pas du monde de la préhistoire puisque j’ai d’abord fait des études pour être ingénieure en génie biologique et chimique. En parallèle de mes études d’ingénieur, j’ai fait une licence d’histoire à distance. Et tout cela a fini par me mener au Master Quaternaire Préhistoire et Bioarchéologie au Muséum National d’Histoire Naturelle.
Et c’est là-bas que j’ai rencontré Alexia, que je vais laisser se présenter.
Alexia : Bonjour à tous, moi c’est Alexia, je suis également la coordonnatrice de Prehistory Travel, (pas de grandes nouveautés juste là). Prehistory Travel, en quelques mots, c’est un projet de médiation scientifique dans le domaine de la préhistoire. Initialement je viens du monde de la communication et du management. J’ai rencontré Mathilde quand j’ai fait le Master Quaternaire Préhistoire et Bioarchéologie au Muséum qui correspondait à une reprise d’études dans mon parcours.
Le concept et contenu du projet Prehistory Travel
Mister Fanjo : Alors peut-être pour spécifier, qu’est-ce qu’on trouve sur votre site et projet ?
Mathilde : Alors, on a un site internet pour Prehistory Travel et on a essayé de créer un écosystème autour de la préhistoire. On a notamment des articles où on aborde de façon plus détaillée et je pense plus complexe certains sujets en préhistoire. Mais on a également des vidéos que l’on publie sur YouTube. Il faut plutôt voir les vidéos comme des formes condensées et simplifiées des articles. On réalise également des podcasts avec TMDJC, notre podcast qui s’appelle Prehistor’Hic. Pour chaque épisode, on vient débunker une idée reçue sur la préhistoire. On a également plein d’autres choses qui sont en train de se mettre en place. On propose des interventions en milieu scolaire, notamment les écoles primaires. On va également commencer des petits cours en ligne, des conférences ou des lives. On n’est pas encore d’accord exactement sur le nom, mais disons que ce seront des moments d’échange avec notre communauté, où on va aborder un sujet plus en détail en direct.
Alexia : On est aussi extrêmement présents sur les réseaux sociaux au quotidien pour répondre aux questions des personnes, que ce soit Instagram, Facebook, Thread, TikTok, Discord, etc. On essaye d’occuper une “niche écologique”, sur la préhistoire assez complète sur Internet.
Les prémisses du projet
Mister Fanjo : Pour donner un peu de contexte à ce projet, comment vous est venue l’idée ? Et peut-être aussi un peu avant, quelles sont les prémisses ? Comment est venue cette passion pour la préhistoire ?
Mathilde : Moi, j’ai toujours été intéressée par l’histoire et la préhistoire. C’est pour ça que quand j’ai décidé de poursuivre mes études, une fois que j’étais ingénieur, je me suis dirigée vers ce master en particulier. Pour le projet Prehistory Travel, c’est un petit peu plus drôle. Il est né un peu comme ça, en un claquement de doigts. Alexia et moi, on était toutes les deux en M1 la même année. C’est comme ça qu’on s’est connus. Durant une sortie, on était partis dans la forêt de Fontainebleau, pour observer les gravures dans des abris sous roche. Le trajet en RER était long ! Il y avait presque deux heures pour y aller. Et qu’est-ce qu’on a fait durant ces deux heures ? On a commencé à se dire, mais qu’est-ce qu’on va faire après notre master ? Parce que le domaine de la recherche, ça nous intéressait, mais c’est compliqué. On s’est dit, mais c’est dommage, il n’y a pas de médiation, c’est compliqué. La préhistoire, c’est très mal connu du grand public. Dès que vous regardez sur les réseaux sociaux, les médias,… , c’est un petit peu massacré. On s’est dit, c’est dommage, il n’y a rien. Du coup, on s’est regardé, on s’est dit : et si on faisait quelque chose ? C’est Alexia qui m’avait posé cette question, et moi j’ai dit oui. Prehistory Travel est né comme ça. Pendant toute la journée, on a discuté, qu’est-ce qu’on pourrait faire, sous quel angle, etc. Au fur et à mesure, le projet s’est construit.
Alexia : Et même, on a été renforcées par cette idée au cours de la suite de nos études. Parce qu’il y a eu plusieurs fois des enseignants qui expliquaient la difficulté qu’il y avait aujourd’hui à faire le lien entre la recherche et le grand public. Même les articles de vulgarisation qu’il y a dans les magazines connus ou même les documentaires déformaient totalement ce qui se trouvait dans les articles scientifiques. Il y avait même des questions qui étaient posées sur comment lier de nouveau la recherche et le grand public. Et on s’est dit, c’est parfait, on va dans la bonne direction. C’est aussi pour ça qu’on a la chance d’avoir des chercheurs qui acceptent de relire les articles que l’on écrit avant de les publier en ligne parce qu’on est tous sensibilisés avec l’importance de la médiation en préhistoire pour le grand public.
Prehistory Travel : un side-business pour le moment
Mister Fanjo : Vous avez commencé pendant vos études à monter le projet. Et là, vous avez terminé vos études et le projet suit son cours. Mais du coup, est-ce que vous avez un travail en parallèle ?
Mathilde : Alors oui. Moi, je suis prof particulière pour des agences où j’habite et je suis également community manager.
Alexia : Je donne des cours particulier de français aux étrangers et je suis également community manager.
Mister Fanjo : Est-ce qu’à terme, vous aimeriez vivre de ce projet et faire ça à temps plein ?
Mathilde : L’objectif principal, c’est que Prehistory Travel devienne une entreprise qui soit rentable, tant pour Alexia et moi que pour l’équipe qu’on a derrière.
L’équipe derrière le projet
Mister Fanjo : Là, actuellement, vous êtes entouré de personnes qui relisent vos travaux. Il y a aussi sûrement des personnes qui développent le site. Est-ce que vous pourriez préciser qui est exactement derrière le projet Prehistory Travel ?
Alexia : On a la société SLWD qui édite des sites internet, qui s’occupe de notre site internet. Pour le design de notre logo, on a travaillé avec un UX designer qui s’appelle Xavier Potin. Pour toute la partie montage vidéo, film,… nous avons la société <Line Sud?>. Pour toute la partie podcast et prise de son sur nos vidéos, nous avons TMDJC, dont parlait Mathilde tout à l’heure. Nous avons également Lucie Viollet qui vient très régulièrement nous coiffer et nous maquiller pour nos vidéos quand elle est disponible. On a Maxence Lefebvre qui est notre homme à tout faire, qui va prendre le temps de relire, commenter, regarder quand il y a des tests à faire sur les sites internet. C’est un peu notre cobaye, je ne sais pas si c’est très positif. C’est aussi notre modérateur TikTok. On a aussi nos modérateurs TikTok sur les lives qui modèrent tout simplement, parce que quand il y a des centaines de personnes en instantané qui posent des questions, il faut mieux avoir des modérateurs qui sont là pour modérer tout ça. On a vraiment tout un écosystème de Prehistory travel derrière.
L’organisation au quotidien
Mister Fanjo : Et au quotidien, comment s’organise votre activité sur ce projet ?
Mathilde : On a chacun des pôles dont on s’occupe de façon privilégiée. Je dirais qu’en gros, Alexia est plutôt sur la partie réseaux sociaux. Qui demande énormément de temps pour poster, pour commenter aussi nos publications, pour nous faire connaître. Et moi je vais plutôt être sur l’autre partie qui va plutôt être rédaction des articles, publication des articles sur le site internet, aider à la correction des vidéos YouTube, la partie rédaction, bibliographie, etc. Les deux demandent énormément de temps et on ne peut pas chacune consacrer du temps aux deux pôles. On s’organise chacune comme on peut, entre nos emplois du temps et nos obligations professionnelles. On essaie de faire avancer le projet au fur et à mesure.
Les prestations dans les écoles et auprès des particuliers
Mister Fanjo : Et pour la partie intervention dans les écoles, est-ce que vous y allez toutes les deux ou vous répartissez les rôles ou c’est seulement l’une ou l’autre ?
Alexia : Ça dépend. Ce sont les écoles qui nous contactent. Même si on a des projets fixés sur notre site Internet, on s’adapte totalement aux besoins des écoles parce qu’à chaque fois, ils disent “ça ça m’intéresse, mais ça aussi, et puis éventuellement ça pour cette classe, mais plutôt ça pour celle-là”. Donc, il y a toute une étape, quand l’on rencontre les écoles, pour créer le projet par rapport à leur projet. Soit on y va toute seule, soit on y va à deux s’il y a besoin. On a aussi des demandes de particuliers. D’ailleurs, la semaine dernière, j’ai été animer l’anniversaire d’une petite fille qui rêve d’être archéologue. Donc on fait aussi des choses qui sortent un petit peu de l’ordinaire. On s’adapte vraiment aux demandes et aux besoins. Je ne peux pas parler de tous les projets, mais il y a d’autres choses qui vont arriver normalement pour la rentrée si tout se passe bien, qui seront encore différents de ce que je viens de citer. Donc voilà, à chaque fois, c’est est-ce qu’il y a besoin d’être deux ? Est-ce qu’ils veulent aussi être deux ? Parce qu’évidemment, ce n’est pas la même tarification si on est là toutes les deux, en fonction du sujet aussi, parce qu’il y a des sujets où Mathilde est plus à l’aise que moi et inversement. Donc voilà, on adapte en fonction de tout ça.
Les différents canaux Prehistory Travel
Mister Fanjo : Et si des gens sont intéressés par vos travaux et s’ils souhaitent passer par vos prestations, où est-ce qu’ils peuvent vous retrouver ?
Mathilde : Sur notre site internet prehistorytravel.com, vous pouvez nous contacter directement soit par le site, soit par notre adresse mail silex@prehistorytravel.com.
Mister Fanjo : Je suppose qu’il y a pas mal de canaux entrant, puisque vous avez la chaîne YouTube, le podcast, le site, le réseau personnel, le réseau d’école. Pour l’instant, comment gérez-vous gérez les demandes ? J’entendais qu’il y avait beaucoup de questions aussi qui vous sont remontées. Vous n’avez pas peur que ça grossisse d’un coup de façon exponentielle ?
Alexia : Alors, c’est vrai que c’est du travail. Comme disait Mathilde, c’est plutôt moi qui réponds sur les réseaux sociaux, sur l’adresse mail et ce genre de choses. Au-delà même des gens qui posent des questions parce qu’ils voudraient une prestation, on a tous ceux qui posent des questions parce que soit ils ont entendu un épisode, soit ils ont vu une vidéo, etc. Donc, c’est un travail à part entière, parce qu’évidemment, j’écris aussi des articles. J’essaye de partager mon temps entre toutes les réponses et tout ce qu’il y a à faire. C’est pour ça qu’en général, même si sur la rédaction d’articles avec Mathilde, on s’est répartis les rôles, il y a des articles, c’est plutôt moi qui rédige le premier jet, d’autres c’est plutôt Mathilde. Ensuite, c’est souvent Mathilde qui fait le suivi des articles parce qu’il y a tout ce temps sur les réseaux et les algorithmes qu’il faut faire travailler. Des fois, c’est même moi qui vais directement parler aux gens, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou ce genre de choses. Peut-être que, s’il y a plus de gens qui viennent à moi, mon temps sera moins pris par le fait d’aller aussi vers les gens sur les réseaux sociaux. On espère que ça s’équilibrera. Et si toutefois, on avait trop de questions à un moment donné, ça serait super qu’on ait cette problématique à gérer. Il n’y a pas de soucis, on sait déjà comment on pourrait y faire face, avec d’autres personnes qui pourraient nous aider à répondre en tout cas sur les questions un petit peu récurrentes que l’on peut avoir de temps en temps.
Zoom sur le podcast Prehistor’Hic et les différents formats
Mister Fanjo : Donc si j’essaie de résumer, les gens peuvent à la fois consulter des vidéos sur YouTube qui sont plus de la vulgarisation et des résumés sur des sujets de la préhistoire. Ensuite, en fonction des besoins, vous faites des interventions soit dans les écoles, soit chez les particuliers. Sur le podcast, quelle est la valeur ajoutée que vous mettez en avant ?
Mathilde : Alors, les podcasts abordent des sujets qu’on n’aborde pas forcément en article ou en vidéo. Disons que le podcast Prehistor’Hic, il a son écosystème à part. Il a sa vie de son côté. Le but, c’est de debunker des idées reçues. Par exemple, dans le podcast qui va sortir ce mois-ci, la question était « y’avait-il des femmes chasseuses à la préhistoire ? ». On a déjà parlé du paradoxe obstétrical ? des apports de la paléogénétique en anthropologie, des cycles climatiques, des comportements symboliques qui ne sont pas réservés à notre espèce. Ce sont vraiment des sujets qui sont différents des articles et des vidéos et qui, généralement, sont mal compris par le public. En tout cas, on voit passer un peu tout et n’importe quoi sur les réseaux. Pour nous, c’est l’occasion durant 30 à 40 minutes de remettre les choses au clair dans une discussion.
Alexia : Chaque partie de Prehistory Travel, c’est une partie du puzzle de notre écosystème, comme disait Mathilde. On adapte aussi nos posts sur les réseaux sociaux. C’est-à-dire que si vous nous suivez sur Thread, X, LinkedIn, Instagram, Facebook (Alors Instagram et Facebook, c’est les mêmes posts) mais les autres c’est des posts qui sont adaptés. Vous pouvez avoir des informations différentes sur Discord où c’est plus de la discussion. On va poster des articles scientifiques qui viennent de sortir pour tenir les gens au courant des dernières actualités, etc. On essaye vraiment qu’une personne qui s’intéresse à la préhistoire, mais qui ne sait pas vraiment par où commencer, puisse trouver quelque chose où elle va plutôt accrocher. Parce qu’il y en a qui sont plutôt visuels, il y en a qui sont plutôt auditifs, il y en a qui vont préférer directement des explications extrêmement pointues, il y en a au contraire, qui veulent juste quelques bribes d’informations pour vérifier quelque chose qu’ils ont lu ailleurs. On essaie vraiment de proposer au public un large panel de choses dans lequel ils vont pouvoir se reconnaître et se sentir assez à l’aise pour pousser la recherche.
La monétarisation du projet
Mister Fanjo : Félicitations parce que c’est un gros travail et surtout je trouve que c’est bien pensé parce que vous avez un peu le contenu spécifique, le contenu vulgarisateur, le contenu très court. En termes de monétisation du projet, vous avez des prestations, est-ce que vous avez d’autres produits, d’autres services ?
Mathilde : Pour l’instant, en dehors des prestations pour les écoles et les particuliers, on n’a pas forcément d’autres produits pour l’instant. On a des idées, mais on va les mettre en place plutôt dans l’année prochaine ou dans les deux ans, parce qu’il fallait déjà créer l’écosystème. Au départ, c’était déjà beaucoup de travail, donc on a priorisé certaines choses. Après, du point de vue de la monétisation, on espère monétiser notre chaîne YouTube à un moment. Et également notre TikTok, qui a une vraie valeur ajoutée par rapport au reste et notamment aux autres réseaux sociaux. Puisque sur TikTok, on fait des vidéos qui sont très courtes sur plein de sujets différents, ça va être juste un point particulier de la préhistoire. Du coup, on aborde des sujets qui sont bien plus différents que ce qu’on peut faire sur le site Internet à travers les articles, etc. On parle notamment beaucoup plus des actualités scientifiques sur TikTok. Donc, on espère aussi pouvoir à un moment monétiser TikTok, ce qui nous permettrait, nous, de rémunérer surtout TMDJC pour les podcasts, la Société <Line Sud?>, etc. De pouvoir au fur et à mesure faire vivre tout le monde en plus d’Alexia et moi-même, et pouvoir aussi créer toujours plus de contenus intéressants autour de la préhistoire. Comme le disait Alexia, c’est un énorme investissement de temps. Du coup, si on souhaite faire quelque chose qui soit vraiment qualitatif, on espère qu’à terme ça pourra nous aider à en faire toujours plus pour la préhistoire.
Alexia : On a aussi sur notre site internet notre Patreon et une plateforme de dons. Il y a beaucoup de gens qui s’abonnent, soit mensuellement avec Patreon, avec des dons à certains instants, notamment parce qu’ils viennent de suivre un live sur TikTok, ça leur a plu, et ils veulent venir contribuer un petit peu. Il y a aussi ça qui nous permet de fonctionner. Et puis, il y a d’autres projets, dont un gros projet sur lequel on travaille en ce moment aussi, pour lequel on est rémunéré. Je ne peux pas vraiment en parler, je pense. Pour l’instant, c’est secret. Il est encore secret pour l’instant, mais il y a d’autres choses derrière qui se mettent en place, mais on doit garder aussi le secret sur certaines choses. Mais voilà, on a aussi des contrats à côté, toujours liés avec Prehistory Travel et la préhistoire, mais pour mettre encore en place d’autres choses à ce niveau-là.
Mister Fanjo : Combien vous rapporte les dons et les abonnements mensuels ? Si c’est pas indiscret.
Alexia : Je n’ai pas de calcul exact, mais pour l’instant, c’est en train de monter. C’est-à-dire que le premier mois, on a peut-être eu un euro. J’exagère un peu, on a peut-être eu 5 euros. Le mois dernier, je crois qu’on est autour de 150 euros, 200 euros, quelque chose comme ça. Ça dépend vraiment de ce qu’on fait. Sur TikTok, les gens envoient des petits cadeaux pendant les lives. Pour l’instant, cet argent, on l’a laissé sur TikTok. Il n’y a pas non plus une fortune. Il doit y avoir 40 euros dessus. Il faut aussi penser aux personnes qui donnent à travers TikTok. Je pense que si on cumule avec ce qu’on a fait sur TikTok et tout, on doit être sur le mois dernier, ou peut-être les deux derniers mois autour de 150/200€. Les gens en général sont assez généreux quand ils font des dons sur Stripe à travers notre site internet, on est autour de 25 euros par don quasiment, donc ça monte assez vite. Et puis, on a des followers, je pense notamment à Gamol, qui nous suivent absolument partout, qui est abonné à notre Patreon. Il y a des gens comme ça qui ont un investissement important dans Prehistory Travel, donc on les salue, bien évidemment.
L’avenir de Prehistory Travel
Mister Fanjo : Comment est-ce que vous voyez l’avenir sur le moyen terme d’ici trois ou cinq ans ? Comment est-ce que vous aimeriez organiser votre quotidien autour de ce projet ?
Alexia : Dégager plus de temps pour Prehistory Travel, ça serait l’idéal. Si on a plus de dons, de personnes qui s’abonnent aussi au Patreon, si on arrive à monétiser certaines choses, on va pouvoir moins travailler à côté. On est toutes les deux à notre compte avec Mathilde, ça nous permet aussi de moduler en fonction de l’avancée. Plus Prehistory Travel grossit, plus on va pouvoir réduire ce qu’on fait à côté, donc plus on va pouvoir produire. Il faut savoir que Prehistory Travel, ce fameux jour où nous étions dans le train, il y avait quand même une heure et demie de transport. En une heure et demie, je pense qu’on a imaginé Prehistory Travel sur les 10 à 15 ans à venir. Donc, ce n’est pas les projets qui nous manquent et les idées. On a une foule d’idées et de choses que l’on peut faire autour de ça. Ça va vraiment être fonction de l’argent que l’on arrive à récupérer qui va nous permettre de nous libérer du temps, qui va nous permettre aussi, comme le disait Mathilde, de rémunérer les personnes qui travaillent avec nous. Donc, plus on a de l’argent, plus on peut faire des choses pour Prehistory Travel et se concentrer dessus et développer la montagne d’idées qu’il y a derrière.
Les questions rafales
Mister Fanjo : OK. Je ne sais pas si vous avez d’autres sujets que vous aimeriez aborder ou mettre en avant. Sinon, je vous propose peut-être de passer aux questions rafales, si ça vous convient.
Alexia : Je crois qu’on a tout dit sur la partie Prehistory Travel.
Mathilde : Oui, je pense, oui.
Mister Fanjo : J’y vais avec la première question. En général, à quelle heure vous levez-vous le matin et quelle est votre première activité de la journée ?
Mathilde : Je me lève à 7h et je nourris mon chat, parce que sinon elle n’est pas contente.
Alexia : Je me lève à 8h30 et je regarde les réseaux sociaux.
Mister Fanjo : Quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l’espace si l’humanité devait disparaître ?
Mathilde : C’est complexe. Mister Brightside, The Killers.
Alexia : Moi, je me suis dit pourquoi je n’aurais pas le droit de faire un montage de plusieurs musiques, même si c’est une seule musique, un seul fichier que j’envoie après et j’essaierai de mettre un peu tous les styles de musique, quelques extraits de plein de styles différents.
Mister Fanjo : Quelle série, film, documentaire ou chaîne YouTube recommanderiez-vous de regarder ?
Mathilde : Série, je dirais Sherlock, parce que c’est ma série préférée de tous les temps. Chaîne YouTube, je peux vous recommander Entracte Science.
Alexia : Chaîne YouTube, Entracte Science. Et au niveau des séries, c’est très compliqué parce qu’il y en a plein que j’adore, mais je dirais The Big Bang Theory, parce que c’est quand même la série où j’ai le plus rigolé dans ma vie, j’en ai pleuré de rire.
Mister Fanjo : Quelles applications ou logiciels utilisez-vous le plus ?
Mathilde : TikTok et Canva pour faire des posts pour nos réseaux sociaux.
Alexia : TikTok énormément. Discord, pas mal aussi. Messenger, mais ça c’est plus personnel. Sinon d’un point de vue Prehistory Travel, énormément TikTok. Instagram, Facebook, je passe un temps infini sur les réseaux sociaux.
Mister Fanjo : Pratiquez-vous un sport ou une activité physique ?
Mathilde : Oui, la course à pied et le yoga.
Alexia : Oui, me lever chaque matin
Mister Fanjo : Admettons que l’on vous donne 100 euros, dans quoi les dépenseriez-vous ?
Mathilde : Dans des livres.
Alexia : Dans des livres.
Mister Fanjo : Avez-vous un principe, une maxime ou une habitude que vous conseilleriez à tout le monde de suivre ?
Mathilde : Est-ce qu’on a des habitudes saines, nous ? C’est ça, le truc ?
Alexia : On ne peut pas dire : buvez du champagne si vous faites une société.
Alexia : Moi, je disais, ne laissez jamais quelqu’un venir à vous et repartir sans être plus heureux. C’est une citation de Mère Thérésa et c’est quelque chose que je me répète souvent dans ma petite tête.
Mathilde : Prenez 5 minutes par jour pour lire ou faire ce que vous voulez. Parce que c’est vrai que quand on est auto-entrepreneur, on a tendance à ne pas prendre de temps pour soi parce qu’on est tous débordés et on est tout seul pour gérer notre barque. Mais même si c’est le cas, essayez quand même de prendre au moins 5-10 minutes par jour juste pour vous. Parce que sinon, vous n’allez pas tenir sur la durée.
Mister Fanjo : Si vous étiez président et que vous aviez le pouvoir de faire aboutir n’importe quelle réforme, que changeriez-vous en priorité ?
Mathilde : Le système de l’éducation en France.
Alexia : Le système de l’éducation en France. La première chose que je changerais, c’est que je remettrais aux parents le droit d’enseigner l’école à la maison. Parce que tous les chiffres montraient que ce n’était pas lié à l’obscurantisme religieux du tout et que ça aidait surtout principalement les enfants qui étaient soit en sport études, soit en échec scolaire, en phobie sociale, etc. Et une pensée pour tous ces enfants, du coup, que ça aidait énormément d’école à la maison. Et aujourd’hui, c’est devenu très compliqué pour les parents d’obtenir ces autorisations. Et ça dépend en plus en fonction des académies. Donc, je travaillerai là-dessus.
Mister Fanjo : De quels accomplissements êtes-vous le plus fières ?
Mathilde : C’est dur ça. Est-ce qu’on a accompli quelque chose déjà qui mérite d’être souligné ? J’ai envie de dire prehistoric travel, mais prehistoric travel n’est pas complètement abouti, donc je ne sais pas si on peut dire que c’est un accomplissement en soi. Sinon, quand j’étais plus jeune, j’ai fait du sport à haut niveau et j’ai gagné les championnats de France en voltige équestre. J’imagine que ça peut être considéré comme un accomplissement. En tout cas, j’en suis plutôt fière.
Alexia : J’ai fait du sport de haut niveau aussi quand j’étais plus jeune, donc je vais copier Mathilde et je vais dire j’ai quand même fait 7 ans de sport études de patinage artistique et je me demande comment j’ai fait parce que je me levais tous les matins à 6h moins quart, je passais trois heures sur la glace, je faisais ensuite une heure de préparation physique, j’allais à l’école et le soir souvent j’allais en plus prendre des cours de danse pour compléter ma formation. Je ne sais pas comment j’ai survécu à ce rythme-là pendant 7 ans. Je sais que j’étais passionnée, que j’étais obsédée, mais je pense que je suis assez fière d’avoir réussi à faire ça, même si j’en serais incapable aujourd’hui.
Mister Fanjo : Vous avez le mot de la fin. Que voulez-vous dire pour conclure cette interview ?
Mathilde : C’est dur aussi. Qu’est-ce qu’on peut dire en mot de la fin ? Il faut un mot de la fin qui soit bien, qui marque les gens. Buvez du champagne ! C’est toujours pas ça.
Alexia : Courage.
Mathilde : Non, c’est pas ça non plus.
Alexia : Soyez curieux, n’hésitez pas à aller dans des choses diverses et variées. Si vous avez envie un jour de reprendre vos études comme je l’ai fait après dix ans sans rien faire niveau études, j’ai envie de dire, faites-le, rêvez grand et soyez heureux.
Mathilde : J’approuve.
Les liens vers les travaux des invités
► Le site Prehistory Travel : https://www.prehistorytravel.com/
Consulter de nouvelles interviews


 ➽ Découvrons l’interview de Valérie Sauvage. Coach, formatrice et spécialiste en développement personnel, elle est aussi auteure du livre : Devenir le profil irrésistible. C’est parti ! ✅
➽ Découvrons l’interview de Valérie Sauvage. Coach, formatrice et spécialiste en développement personnel, elle est aussi auteure du livre : Devenir le profil irrésistible. C’est parti ! ✅

 Découvrons l’interview de Stefan Lendi, le créateur de la marque StrategeMarketing et l’auteur de plusieurs ouvrages dont : Le marketing digital à l’ère de l’IA et du Web3. C’est parti !
Découvrons l’interview de Stefan Lendi, le créateur de la marque StrategeMarketing et l’auteur de plusieurs ouvrages dont : Le marketing digital à l’ère de l’IA et du Web3. C’est parti !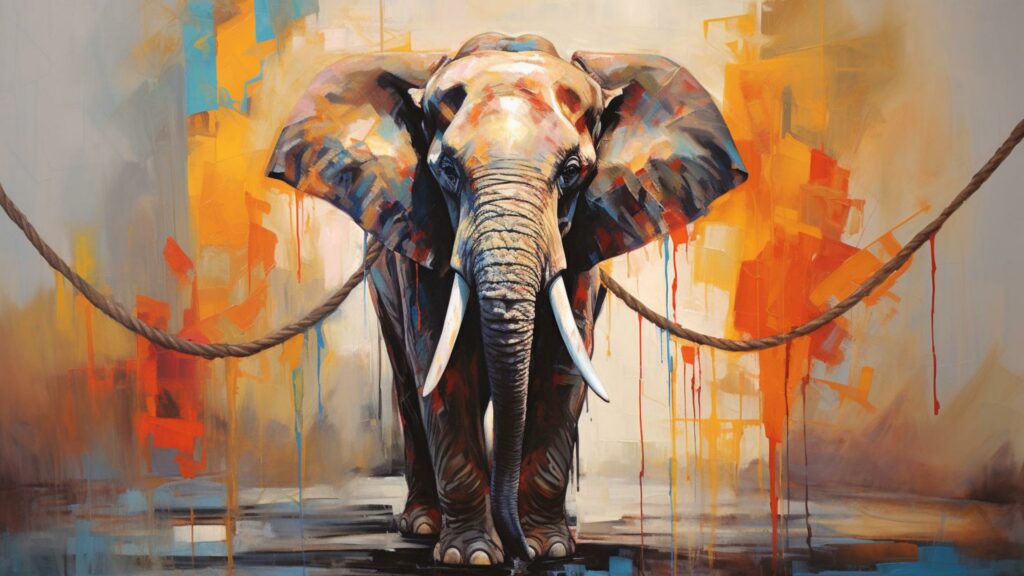 ➽
➽